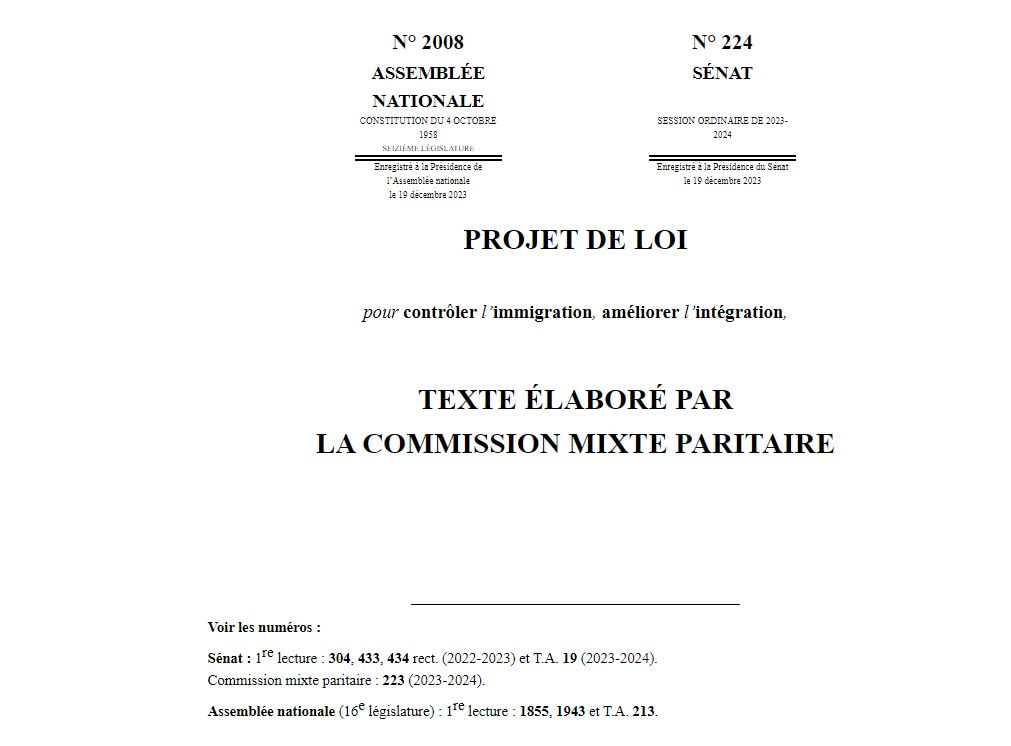LOI DARMANIN - CIOTTI - LE PEN DU 19/12/2023: une vraie loi de régression des droits des étrangers.20/12/2023
Oui, les programmes de Jean Marie Le Pen puis Marine Le Pen sont devenus loi.
|
|||||||
| ta_de_grenoble_cdi_aide_casf_pour_étrangers_même_en_séjour_irrégulier.pdf | |
| File Size: | 250 kb |
| File Type: | |
Il y a encore plus de 300.000 gardes à vue chaque année en France malgré les récentes réformes tendant à en restreindre l’usage.
Outil majeur de l’enquête de police ou de gendarmerie, le cadre légal pour entendre un suspect, une personne soupçonnée, voire un simple un témoin a considérablement évolué en quelques années notamment par le poids de la Cour européenne des droits de l’homme et la force de la profession d’avocat.
La Cour de cassation, le Conseil constitutionnel ont amené progressivement par leur jurisprudence à accepter quelques avancées vers plus de modernité et à respecter un peu mieux les standards des droits fondamentaux que respectent les grandes démocraties (lesquelles ont, par exemple, pris la directive 2012/13/UE du Parlement européen relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales que la France a péniblement transposée par une loi du 11 juin 2016).
Tout cela sans sérieusement nuire à l’enquête qui s’intéressera davantage aux éléments autres que l’aveu, « reine des preuves », si fragile pour établir le crime.
Concrètement, une personne est désormais entendue librement ou dans le cadre d’une garde à vue dont le régime juridique diffère mais dont le but est le même : recueillir des explications du suspect ou de la personne soupçonnée.
Hors le cas d’une arrestation, cela peut commencer par une convocation de police qui en pratique donne bien des indications à son destinataire et lui permet de se préparer à ce qui est tout sauf anodin.
Depuis le 1er janvier 2015 et en application de l’article 61-1 du Code de procédure pénale, la convocation pour une audition libre de la personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction doit indiquer l’infraction dont elle est soupçonnée et son droit d’être assisté par un avocat.
Ainsi, toute autre convocation sans une telle mention laisse nécessairement penser qu’il s’agira d’une garde à vue, et non d’une audition libre.
« Le mot que tu retiens entre tes lèvres est ton esclave. Le mot que tu as dit est ton maître. » : pour autant selon le Code de procédure pénale, le droit au silence, celui de ne pas s’auto-incriminer n’a pas à être rappelé dans la convocation ainsi faite.
Ce droit sera néanmoins rappelé par l’enquêteur avant l’audition libre proprement dite conformément aux dispositions de l’article 61-1.
L’avocat permettait d’obtenir cette information dans le cadre du simple « entretien de courtoisie » qu’il avait avec son client avant la réforme du 14 avril 2011.
Le fait que l’avocat assiste désormais son client pendant les interrogatoires rend effectif l’exercice de ce droit. L’enquêteur n’a guère d’espoir de faire renoncer au silence celui qui, fort du soutien juridique de son avocat, a décidé d’exercer ce droit fondamental.
C’est la même logique pour celui qui décide de répondre aux questions. Répondre aux questions ne signifie pas répondre à toutes les questions, même les plus insidieuses, de celles qui vous feraient dire le contraire de ce que vous souhaitez expliquer.
« Chercher à se justifier quand on n’est pas coupable, c’est s’accuser » : il y a donc souvent un stade à partir duquel il faut savoir mettre un terme à l’interrogatoire ou en rendre la poursuite complètement vaine.
Et tout au long de l’interrogatoire, il y a des vigilances qu’une personne non avisée ne pourra bien sûr pas avoir.
La convocation écrite préalable est désormais prévue par la loi (« si le déroulement de l’enquête le permet », selon le texte).
Ainsi c’est toute la panoplie des droits qu’une personne appelée à se rendre dans un commissariat de police ou une gendarmerie viendra chercher au préalable chez son avocat.
C’est en pratique ce qu’elle fait le plus souvent.
Nombres de personnes exposées à un risque pénal par leurs fonctions ou par hasard tirent le meilleur parti à apprendre les rouages de la procédure pénale, les astuces pour « bien vivre » la garde à vue ou réduire la durée d’un interrogatoire et en optimiser le contenu.
Tant et si bien que les cabinets d’avocats faisant référence en la matière ont mis en place des formations destinées à faire face au risque pénal.
Elles répondent à un besoin. Elles découlent des réformes tendant à renforcer les droits de la défense et l’équilibre de la procédure pénale.
Chefs d’entreprise, responsables publics ou privés, particuliers exposés à un risque pénal peuvent ainsi se former sur leurs droits et les bons réflexes pour se prémunir ou se défendre du risque pénal de leur activité.
Sur site ou en cabinet d’avocat, ces « kits de survie du pénaliste » permettent de connaître le cadre légal de l’audition libre et de la garde à vue (qui, quand, pourquoi ? Quels pouvoirs et quels droits ?), de savoir comment se préparer, bien gérer un interrogatoire, et avoir les bons réflexes après et enfin d’avoir une évaluation personnalisée de chacun des participants sur leurs risques particuliers, leurs atouts, leurs faiblesses dans la procédure pénale.
« Un homme averti en vaut deux ». Ce qu’il y a de bien maintenant, c’est qu’on est prévenu.
Outil majeur de l’enquête de police ou de gendarmerie, le cadre légal pour entendre un suspect, une personne soupçonnée, voire un simple un témoin a considérablement évolué en quelques années notamment par le poids de la Cour européenne des droits de l’homme et la force de la profession d’avocat.
La Cour de cassation, le Conseil constitutionnel ont amené progressivement par leur jurisprudence à accepter quelques avancées vers plus de modernité et à respecter un peu mieux les standards des droits fondamentaux que respectent les grandes démocraties (lesquelles ont, par exemple, pris la directive 2012/13/UE du Parlement européen relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales que la France a péniblement transposée par une loi du 11 juin 2016).
Tout cela sans sérieusement nuire à l’enquête qui s’intéressera davantage aux éléments autres que l’aveu, « reine des preuves », si fragile pour établir le crime.
Concrètement, une personne est désormais entendue librement ou dans le cadre d’une garde à vue dont le régime juridique diffère mais dont le but est le même : recueillir des explications du suspect ou de la personne soupçonnée.
Hors le cas d’une arrestation, cela peut commencer par une convocation de police qui en pratique donne bien des indications à son destinataire et lui permet de se préparer à ce qui est tout sauf anodin.
Depuis le 1er janvier 2015 et en application de l’article 61-1 du Code de procédure pénale, la convocation pour une audition libre de la personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction doit indiquer l’infraction dont elle est soupçonnée et son droit d’être assisté par un avocat.
Ainsi, toute autre convocation sans une telle mention laisse nécessairement penser qu’il s’agira d’une garde à vue, et non d’une audition libre.
« Le mot que tu retiens entre tes lèvres est ton esclave. Le mot que tu as dit est ton maître. » : pour autant selon le Code de procédure pénale, le droit au silence, celui de ne pas s’auto-incriminer n’a pas à être rappelé dans la convocation ainsi faite.
Ce droit sera néanmoins rappelé par l’enquêteur avant l’audition libre proprement dite conformément aux dispositions de l’article 61-1.
L’avocat permettait d’obtenir cette information dans le cadre du simple « entretien de courtoisie » qu’il avait avec son client avant la réforme du 14 avril 2011.
Le fait que l’avocat assiste désormais son client pendant les interrogatoires rend effectif l’exercice de ce droit. L’enquêteur n’a guère d’espoir de faire renoncer au silence celui qui, fort du soutien juridique de son avocat, a décidé d’exercer ce droit fondamental.
C’est la même logique pour celui qui décide de répondre aux questions. Répondre aux questions ne signifie pas répondre à toutes les questions, même les plus insidieuses, de celles qui vous feraient dire le contraire de ce que vous souhaitez expliquer.
« Chercher à se justifier quand on n’est pas coupable, c’est s’accuser » : il y a donc souvent un stade à partir duquel il faut savoir mettre un terme à l’interrogatoire ou en rendre la poursuite complètement vaine.
Et tout au long de l’interrogatoire, il y a des vigilances qu’une personne non avisée ne pourra bien sûr pas avoir.
La convocation écrite préalable est désormais prévue par la loi (« si le déroulement de l’enquête le permet », selon le texte).
Ainsi c’est toute la panoplie des droits qu’une personne appelée à se rendre dans un commissariat de police ou une gendarmerie viendra chercher au préalable chez son avocat.
C’est en pratique ce qu’elle fait le plus souvent.
Nombres de personnes exposées à un risque pénal par leurs fonctions ou par hasard tirent le meilleur parti à apprendre les rouages de la procédure pénale, les astuces pour « bien vivre » la garde à vue ou réduire la durée d’un interrogatoire et en optimiser le contenu.
Tant et si bien que les cabinets d’avocats faisant référence en la matière ont mis en place des formations destinées à faire face au risque pénal.
Elles répondent à un besoin. Elles découlent des réformes tendant à renforcer les droits de la défense et l’équilibre de la procédure pénale.
Chefs d’entreprise, responsables publics ou privés, particuliers exposés à un risque pénal peuvent ainsi se former sur leurs droits et les bons réflexes pour se prémunir ou se défendre du risque pénal de leur activité.
Sur site ou en cabinet d’avocat, ces « kits de survie du pénaliste » permettent de connaître le cadre légal de l’audition libre et de la garde à vue (qui, quand, pourquoi ? Quels pouvoirs et quels droits ?), de savoir comment se préparer, bien gérer un interrogatoire, et avoir les bons réflexes après et enfin d’avoir une évaluation personnalisée de chacun des participants sur leurs risques particuliers, leurs atouts, leurs faiblesses dans la procédure pénale.
« Un homme averti en vaut deux ». Ce qu’il y a de bien maintenant, c’est qu’on est prévenu.

Saluons le mérite des forces de l'ordre dont la tâche est rendue d'autant plus difficile que leurs effectifs ont connu une baisse sans précédent lors du précédent mandat présidentiel. Rappelons tout de même les carences du système législatif permettant de contrôler leur action.
L’action des forces de l’ordre est par nature brutale face au désordre, au trouble à l’ordre public ou à la commission d’un crime.
Les coups de bâton donnés généreusement pour disperser des manifestants, le jet de bombe lacrymogène, le tir potentiellement létal même s’il est réglementairement dirigé d’abord sur des organes non vitaux, autant d’actions que la loi permet aux policiers ou gendarmes d’effectuer en toute impunité.
L’ « usage de la force strictement nécessaire » : c’est toujours en ces termes que le débat judiciaire est posé en cas de violences policières.
Pour les uns, un coup gratuitement donné à un manifestant soumis sera l’usage de la force strictement nécessaire pour les autres.
Chacun a raison de son point de vue. La frontière est parfois ténue entre la violence légitime et la brutalité de trop.
L’état d’urgence (qui a grandement facilité l’action des forces de l’ordre par une absence presque totale de contrôle judiciaire) et ses perquisitions traumatisantes pour ceux qui les ont subies, ou encore les manifestations populaires autour du projet de réforme du code du travail portée par la ministre EL KHOMRI, sans parler de la tragédie dont a été victime Rémi Fraisse ont donné quelques exemples pratiques des limites de la législation française. Une fois encore.
Des décennies que la France prête le flanc à la critique par une règlementation parfaitement défaillante.
Quand l’opportunité de la violence doit être jugée, la question de la preuve des gestes effectués par les uns ou les autres est évidemment centrale.
Dans l’espace public, peut être évacué plus aisément le problème de la preuve qui se pose réellement lorsque les faits se sont déroulés à l’intérieur d’un commissariat ou d’une caserne de gendarmerie ou d’un lieu clos sans regard extérieur.
Les technologies modernes fixent les faits que la justice doit ensuite qualifier.
C’est principalement les enregistrements d’images par des témoins de la scène. Demain peut être par les policiers eux-mêmes équipés d’une « caméra piéton » à la condition qu’ils activent l’enregistrement. Les caméras de vidéosurveillance de manière accessoire lorsque leurs images sont exploitables (ce qui est rare) et exploitées (ce qui l’est tout autant).
Quand les images n’existent pas ou qu’elles sont équivoques, le recueil des témoignages des victimes, témoins et auteurs reste la seule méthode d’établissement des faits.
Et c’est là que le bât blesse.
En procédure, la victime est entendue le plus souvent par l’auteur ou ses collègues au mépris des règles d’équité les plus élémentaires.
Dans le meilleur des cas, elle le sera en qualité de victime, et sinon comme mis en cause pour outrage et rébellion, infractions facilement relevées.
Il est assez rare en effet que la victime se laisse molester injustement sans l’ouvrir, ou sans tenter d’échapper aux coups.
En France, toujours pas d’enquête officielle effective par un organe indépendant. Au mieux, la classique enquête de l’IGPN ou de l’IGGN. Or l’enquête « maison » dont on connaît souvent par avance les conclusions n’est pas l’enquête réclamée depuis des décennies par les organes de défense des droits de l’homme.
Amnesty International acquiert ses lettres de noblesse lorsqu’elle se penche sur la situation de pays étrangers à la France. Elle est vilipendée lorsqu’elle publie des rapports accablants sur l’état de notre droit français en la matière (http://www.amnesty.fr/Documents/Rapport-France-Des-policiers-au-dessus-des-lois).
L’ACAT fait l’objet des pires accusations lorsqu’elle mène une enquête rigoureuse pour, non pas critiquer la police dont tout le monde s’accorde, particulièrement en ces temps troublés, à dire qu’elle est utile et même insuffisante, mais pour faire plus de transparence sur les pratiques que l’on souhaiterait tous, y compris dans les rangs des forces de l’ordre, être d’un autre âge et y rester (http://www.acatfrance.fr/action/violences-policieres---exigeons-la-transparence).
Ce que ces organisations préconisent n’est rien d’autre que ce que les engagements internationaux de la France, telle la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, imposent.
L’article 13 de la CEDH prévoit que :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à plusieurs reprises, notamment dans deux arrêts retentissants, pour des traitements inhumains et dégradants commis à l'occasion d'une mesure de garde à vue (Tomasi c/ France, CEDH 27 août 1992 et Selmouni c/ France, CEDH 28 juill. 1999).
La Cour considère que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l’Etat, de graves sévices illicites, il faut qu’il y ait une enquête officielle effective. (Assenov c. Bulgarie C.E.D.H. 28 octobre 1998).
Sans une telle enquête, «il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle ».
Le Défenseur des Droits, dont la France a fini par se doter, assure un rôle certes fondamental pour effectuer une enquête indépendante et impartiale qu’il mène en plusieurs mois, plusieurs années parfois.
Il est lui aussi critiqué par ceux-là même dont il démontre les exactions (http://www.alternativepn.fr/pages/communique.html).
Néanmoins, il n’empêche pas les comparutions immédiates des victimes de violences policières que la justice est prompte à condamner pour outrage et rébellion dans le cadre de procédures inéquitables et expéditives.
Sa sagesse, lorsqu’elle est seulement écoutée, passe après que l’action publique ait fait son œuvre.
Il n’empêchera pas davantage les dérives liées à l’assouplissement des conditions dans lesquelles les forces de l’ordre pourront faire usage de la force strictement nécessaire, y compris létale, jusqu’alors réserver à des situations de grave danger, actuel en légitime défense ou imminent en état de nécessité (article 19 du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale).
La police est partout et quand elle protège, elle est la bienvenue.
La justice n’est nulle part lorsqu’elle ne permet pas de faire la lumière sur les excès des forces de l’ordre.
L’action des forces de l’ordre est par nature brutale face au désordre, au trouble à l’ordre public ou à la commission d’un crime.
Les coups de bâton donnés généreusement pour disperser des manifestants, le jet de bombe lacrymogène, le tir potentiellement létal même s’il est réglementairement dirigé d’abord sur des organes non vitaux, autant d’actions que la loi permet aux policiers ou gendarmes d’effectuer en toute impunité.
L’ « usage de la force strictement nécessaire » : c’est toujours en ces termes que le débat judiciaire est posé en cas de violences policières.
Pour les uns, un coup gratuitement donné à un manifestant soumis sera l’usage de la force strictement nécessaire pour les autres.
Chacun a raison de son point de vue. La frontière est parfois ténue entre la violence légitime et la brutalité de trop.
L’état d’urgence (qui a grandement facilité l’action des forces de l’ordre par une absence presque totale de contrôle judiciaire) et ses perquisitions traumatisantes pour ceux qui les ont subies, ou encore les manifestations populaires autour du projet de réforme du code du travail portée par la ministre EL KHOMRI, sans parler de la tragédie dont a été victime Rémi Fraisse ont donné quelques exemples pratiques des limites de la législation française. Une fois encore.
Des décennies que la France prête le flanc à la critique par une règlementation parfaitement défaillante.
Quand l’opportunité de la violence doit être jugée, la question de la preuve des gestes effectués par les uns ou les autres est évidemment centrale.
Dans l’espace public, peut être évacué plus aisément le problème de la preuve qui se pose réellement lorsque les faits se sont déroulés à l’intérieur d’un commissariat ou d’une caserne de gendarmerie ou d’un lieu clos sans regard extérieur.
Les technologies modernes fixent les faits que la justice doit ensuite qualifier.
C’est principalement les enregistrements d’images par des témoins de la scène. Demain peut être par les policiers eux-mêmes équipés d’une « caméra piéton » à la condition qu’ils activent l’enregistrement. Les caméras de vidéosurveillance de manière accessoire lorsque leurs images sont exploitables (ce qui est rare) et exploitées (ce qui l’est tout autant).
Quand les images n’existent pas ou qu’elles sont équivoques, le recueil des témoignages des victimes, témoins et auteurs reste la seule méthode d’établissement des faits.
Et c’est là que le bât blesse.
En procédure, la victime est entendue le plus souvent par l’auteur ou ses collègues au mépris des règles d’équité les plus élémentaires.
Dans le meilleur des cas, elle le sera en qualité de victime, et sinon comme mis en cause pour outrage et rébellion, infractions facilement relevées.
Il est assez rare en effet que la victime se laisse molester injustement sans l’ouvrir, ou sans tenter d’échapper aux coups.
En France, toujours pas d’enquête officielle effective par un organe indépendant. Au mieux, la classique enquête de l’IGPN ou de l’IGGN. Or l’enquête « maison » dont on connaît souvent par avance les conclusions n’est pas l’enquête réclamée depuis des décennies par les organes de défense des droits de l’homme.
Amnesty International acquiert ses lettres de noblesse lorsqu’elle se penche sur la situation de pays étrangers à la France. Elle est vilipendée lorsqu’elle publie des rapports accablants sur l’état de notre droit français en la matière (http://www.amnesty.fr/Documents/Rapport-France-Des-policiers-au-dessus-des-lois).
L’ACAT fait l’objet des pires accusations lorsqu’elle mène une enquête rigoureuse pour, non pas critiquer la police dont tout le monde s’accorde, particulièrement en ces temps troublés, à dire qu’elle est utile et même insuffisante, mais pour faire plus de transparence sur les pratiques que l’on souhaiterait tous, y compris dans les rangs des forces de l’ordre, être d’un autre âge et y rester (http://www.acatfrance.fr/action/violences-policieres---exigeons-la-transparence).
Ce que ces organisations préconisent n’est rien d’autre que ce que les engagements internationaux de la France, telle la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, imposent.
L’article 13 de la CEDH prévoit que :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à plusieurs reprises, notamment dans deux arrêts retentissants, pour des traitements inhumains et dégradants commis à l'occasion d'une mesure de garde à vue (Tomasi c/ France, CEDH 27 août 1992 et Selmouni c/ France, CEDH 28 juill. 1999).
La Cour considère que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l’Etat, de graves sévices illicites, il faut qu’il y ait une enquête officielle effective. (Assenov c. Bulgarie C.E.D.H. 28 octobre 1998).
Sans une telle enquête, «il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle ».
Le Défenseur des Droits, dont la France a fini par se doter, assure un rôle certes fondamental pour effectuer une enquête indépendante et impartiale qu’il mène en plusieurs mois, plusieurs années parfois.
Il est lui aussi critiqué par ceux-là même dont il démontre les exactions (http://www.alternativepn.fr/pages/communique.html).
Néanmoins, il n’empêche pas les comparutions immédiates des victimes de violences policières que la justice est prompte à condamner pour outrage et rébellion dans le cadre de procédures inéquitables et expéditives.
Sa sagesse, lorsqu’elle est seulement écoutée, passe après que l’action publique ait fait son œuvre.
Il n’empêchera pas davantage les dérives liées à l’assouplissement des conditions dans lesquelles les forces de l’ordre pourront faire usage de la force strictement nécessaire, y compris létale, jusqu’alors réserver à des situations de grave danger, actuel en légitime défense ou imminent en état de nécessité (article 19 du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale).
La police est partout et quand elle protège, elle est la bienvenue.
La justice n’est nulle part lorsqu’elle ne permet pas de faire la lumière sur les excès des forces de l’ordre.
Le blog
Actualité juridique par Claude COUTAZ, avocat.
Archives
Décembre 2023
Avril 2020
Mars 2020
Avril 2018
Mars 2018
Novembre 2017
Décembre 2016
Septembre 2016
Avril 2016
Novembre 2015
Juin 2015
Juin 2014
Mai 2014
Décembre 2011
Juillet 2011
Février 2011
Décembre 2010
Juillet 2010
Décembre 2009
Septembre 2009
Avril 2009